Nous sommes le 19 avril 1819 à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Jean Marie Ducard, tonnelier, vient accompagné d'un voisin charron et d'un autre charpentier en bateaux déclarer la naissance de sa fille Marie.

Banal acte de la vie quotidienne et base de recherche pour les généalogistes, mais à la lecture apparaissent quelques mots inhabituels ajoutés par l'officier d'état civil: "Le présent acte dressé sur la réquisition à nous faite par ledit Sieur Jean Marie Ducard, père de l'enfant qui a été averti de le faire vacciner".
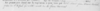
La variole et les débuts de la vaccine
Au XVIII siècle la variole ou "petite vérole" tuait environ 50 à 80 000 personnes en France. Dans les campagnes, certains procédés empiriques étaient utilisés: prélever un peu de pus dans la pustule d'un malade pour l'inoculer à un enfant sain avec l'espoir de développer une forme bénigne de variole mais aussi, malheureusement, un risque élevé d'en mourir.
Jusqu'à la découverte du médecin anglais Edward Jenner qui utilise le "cowpox", la variole de la vache, inoffensive chez l'homme, pour protéger, pour vacciner. (du latin vaca , vache)

Jenner variolisant un petit garçon. ©Coll. Académie de Médecine
La vaccine en France
En 1801 sont mis en place un comité central et des comités départementaux de vaccine. Les autorités civiles et religieuses, les médecins et sages-femmes doivent encourager l'utilisation de la vaccine. Avec des résultats très inégaux et de nombreuses controverses.
En 1804, l'Empereur soutient cette action par la création de la Société pour l'extinction de la petite vérole en France par la propagation de la vaccine.
En 1811 on estime que 2,5 millions de vaccinations ont été pratiquées et que la variole ne tue plus que 5000 personnes par an. Le Bulletin central du Comité de Vaccine triomphe : « Bientôt nous touchons à l’époque où la petite vérole ne sera plus connue que par le souvenir de la terreur qu’elle inspirait et par le sentiment de la reconnaissance pour la pratique salutaire qui nous aura délivrés de ce fléau".

Recommandation vaccinale à Chalon-sur-Saône
Revenons dans cette ville et étudions de nouveau les registres d'état civil. C'est le 2 octobre 1813 que l'adjoint au maire Vivant Bataillard commence à insérer cette injonction au déclarant d'une naissance, "lequel a été averti de le faire vacciner". Cet officier d'état civil a signé les actes qui précèdent, la recommandation n'est donc pas liée à l'arrivée d'un nouvel élu. Peut-être est il passé d'un encouragement oral à écrit.
La phrase disparait au début de 1826. Sentiment du devoir accompli ou fatigue?
sources: Archives départementales de Saône-et-Loire (5E76/8 à 5E76/99); Gallica (BnF, Bibliothèque Nationale de France) ; P. Darmon, Les débuts de la diffusion de la vaccine en France (1800-1850), Académie Nationale de Médecine, 2001.


